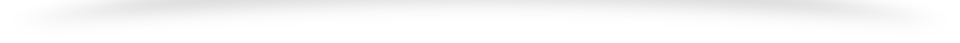Toute monoculture est instable, et la lutte biologique n’est pas une panacée.
Même bio, l’agriculture à grande échelle a trois handicaps majeurs pour être vraiment durable : elle reste essentiellement basée sur des parcelles en monoculture, elle doit se plier aux exigences d’un circuit de distribution industriel, et elle porte les coûts cachés d’un modèle centralisé. Peut-être que la conversion de notre agriculture productiviste aux méthodes biologiques serait l’occasion de désindustrialiser l’agriculture.
Sommaire
Monoculture, déséquilibres, interventionnisme
Les techniques de semis direct sous couvert décrites par exemple par Claude Bourguignon, ou bien testées par les agricoolteurs mettent le respect des sols à la portée de la grande culture. Le sol se reconstitue, la faune endogée prospère, les plantes sont en meilleure santé. C’est révolutionnaire, mais ça reste essentiellement de la monoculture. Une seule variété, semée avec la plus grande régularité sur une vaste parcelle, ça ne fait pas un écosystème. Or la théorie de l’évolution nous apprend une chose : si les écosystèmes spontanés contiennent une telle biodiversité, c’est que c’est justement cette biodiversité qui leur a permis de survivre jusqu’à nous. Il n’y a pas d’écosystème uniforme dans la nature, parce que ces écosystèmes n’ont pas survécu. J’en conclus qu’une parcelle uniforme, propre, rangée, c’est une parcelle en sursis. Même en bio, l’équilibre est instable.
Le meilleur que saurait faire la grande culture, ça serait des parcelles en bandes longues, de la largeur d’une moissonneuse, séparées par des haies champêtres. Et comme un arc-en-ciel, on alternerait les espèces dans les bandes : fraises, blé, soja, taillis de saule, patates, orge, colza, luzerne, ray-grass, re-fraises, etc. Déjà ça, ça serait beau, et peut-être suffisamment stable pour survivre d’une saison sur l’autre. En fait, c’est la haie qui procurerait la biodiversité, puisqu’on y laisserait pousser toutes les espèces végétales possibles, et toute la faune qui va avec. Les prédateurs ne seraient donc jamais à plus d’une-demi fauchée de moissonneuse de leurs proies, ce qui est un gage de robustesse.
Toutefois, ça n’en reste pas moins de longues étendues plantées de la même variété. Et quand un envahisseur atteint une de ces bandes sans que son prédateur naturel soit présent (par exemple un redoux précoce faisant éclore un insecte parasite avant le retour des oiseaux qui s’en nourrissent), c’est toute la bande qui est atteinte. Si l’agriculteur ne peut pas se permettre de perdre une bande, il lui faudra intervenir. Et je suis un farouche libéral en ce qui concerne l’agriculture : toute intervention est un échec, que le traitement soit autorisé par le cahier des charges du label AB ou pas.
Accidents dans la lutte biologique
Même bio, la grande culture restera donc caractérisée par cette fragilité intrinsèque de la monoculture, donc par des accidents et des interventions curatives, suivies de recommandations d’interventions préventives, lesquelles induiront des déséquilibres qui provoqueront d’autres accidents. On risque d’assister au même genre de fuite en avant que dans l’agriculture chimique, simplement avec des produits qu’on considère moins dangereux. La lutte biologique n’est malheureusement pas une panacée et nous offre suffisamment d’exemples de bavures regrettables pour nous inciter à la prudence.
Quelques exemples :
- La myxomatose est un virus d’Amérique du Sud, introduit en Autralie pour contrôler les populations invasives de lapins. Elle a ensuite été introduite en Europe, et a fait des ravages dans nos populations de lapins, si bien que maintenant on doit vacciner nos lapins
- Cactoblastis cactorum est un papillon d’Amérique du Sud introduit en Australie (la répétition est intentionnelle) pour contrôler l’invasion de figuiers de barbarie (Opuntia Ficus-Indica). Cette initiave a longtemps été citée en exemple comme l’une des grandes réussites de la lutte biologique. Sauf que maintenant, la bestiole a gagné l’Amérique Centrale et du Nord, et menaces les espèces endémiques de cactus, ainsi que le revenu agricole de nombreux agriculteurs mexicains.
- Le crapaud buffle est un crapaud d’Amérique du Sud, qui a été introduit en Australie (encore ?) pour manger les insectes parasites de la canne à sucre. Comme il a tendance à empoisonner les prédateurs indigènes, il se répand comme … des lapins.
- La Gambusie est un petit poisson du Golfe du Mexique, qui se nourrit entre autres de larves de moustiques, et qui a été introduit un peu partout pour lutter contre le paludisme. Comme il ne se contente pas de manger les moustiques, il menace de très nombreuses espèces endémiques (en particulier en Australie)
- Rhinocyllus conicus est un genre de charançon natif d’Eurasie et d’Afrique du Nord qui a été introduit en Amérique du Nord pour manger les mauvais chardons. Mais il mange aussi les gentils chardons, et il a fini par mettre en danger les chardons natifs de là-bas.
- Des mangoustes ont été introduites à Hawaii pour venir à bout des invasions de rats. Apparemment, elles préfèrent faire disparaître les espèces endémiques d’oiseaux. [ref]
- etc.
Variétés, et circuits de distribution
La production industrielle produit des quantités industrielles, donc nécessite une distribution industrielle, et in fine du transport. Ce qu’on gagne avec l’efficacité de la mécanisation d’un côté, on le reperd en grande partie en un réseau de transport, de contrôle, et de distribution complexe et ramifié. Il ne faut pas oublier en effet qu’un supermaché, même bio, concentre d’énormes gaspillages, au premier rang desquels les trajets en camion des denrées, les parkings, le chauffage du supermarché pendant qu’on réfrigère les bacs, et les trajets en voiture particulière des consommateurs (qui ne sont jamais comptés).
Pour permettre ce transport et cette distribution, les variétés doivent être sélectionnées non pas pour le goût ou les valeurs nutritives, mais pour la robustesse au stress mécanique et thermique. On continue alors de vivre sur les variétés industrielles de pommes, de tomates, ou de courgettes. Ceci est à nouveau un frein à la diversité.
Quels coûts se cachent derrière les économies d’échelle ?
Comme l’a prouvé Ivan Illitch, une bonne partie du modèle industriel repose sur la foi dogmatique que l’industrialisation d’un système de production conduit toujours à des économies d’échelles. En outre, le miracle du pétrole bon marché a masqué pendant cinquante ans les coûts du transport. S’il est vrai que les débuts de la révolution industrielle (ou de la révolution verte) ont occasionné des augmentations notables de production, il faut se demander si ce n’était pas davantage un effet de modernisation/rationalisation, voire de pillage du patrimoine et des ressources. Je crois que le modèle industriel appliqué à l’agriculture, en oubliant tous les coûts externes, représente en fait des déséconomies d’échelle considérables.
On croit qu’un agriculteur peut nourrir à lui seul des centaines de familles. Un miracle d’efficacité industrielle. En fait, il n’est que le sommet de l’iceberg agroalimentaire, et derrière lui se cachent le technicien de la chambre d’agriculture, le vendeur de tracteurs, l’ouvrier qui a construit le tracteur, son patron, le comptable de son patron, l’agent du Crédit Agricole, le vendeur d’intrants, l’ouvrier qui a construit l’usine qui fabrique les engrais, le chauffeur qui amène les aliments, le chauffeur qui emmène les bêtes, le chauffeur qui amène le fioul, le chauffeur qui distribue les carcasses, le boucher qui découpe les carcasses, le vendeur qui met les steaks sous plastique et en rayon, la caissière qui bipe le code barre, l’ouvrier qui a construit la voiture du consommateur, etc. et j’en oublie.
Environ un septième du revenu des ménages est consacré au budget agro-alimentaire. Ainsi, pour nourrir 100 familles, il faut en fait 13 personnes à plein temps en plus de l’agriculteur pour faire tourner le reste de la filière. Et à chaque fois qu’on veut augmenter la productivité d’un agriculteur, on génère des coûts supplémentaires ailleurs dans la filière (recherche en OGM, nouvelles machines agricoles, transports plus lointains), et de plus en plus souvent à l’extérieur de la filière (santé publique, crises sanitaires et écologiques, subventions, exportations ‘forcées’, misère des pauvres des pays pauvres, délocalisations, appauvrissement des pauvres des pays riches).
Le système industriel n’est donc pas aussi efficace qu’on croit. Et c’est finalement une bonne nouvelle : l’argument ‘c’est trop cher’ ne tient plus, et on peut envisager de revenir à une agriculture paysanne plus gourmande en travail aux champs, sans craindre d’augmenter le coût total.
Quel bon niveau de ‘désindustrialisation’ ?
En effet, une exploitation de plus petite taille, si elle nécessite plus de main d’oeuvre pour produire, demande moins de monde pour distribuer. Contrairement à un Auchan, un marché de producteurs n’a pas besoin de chefs de rayon, de manutentionnaires, de vigiles, d’agents de nettoyage, ou bien de directeur des achats. En passant à des circuits courts, on réduit considérablement les intermédiaires et les surcoûts (plateforme logistique, entrepôts frigorifiques, semi-remorques charriant des cagettes à travers toute l’Europe, …). Une agriculture paysanne demande aussi moins d’investissements en matériel, donc moins d’ouvriers à la chaîne pour construire des gros tracteurs.
Où seront tous ces gens libérés de la nébuleuse agro-alimentaire industrielle ? Aux champs. Si la nouvelle agriculture paysanne n’est pas plus coûteuse que le modèle industriel, alors on aura simplement transformé des travailleurs urbains en paysans. Au passage, en repeuplant ainsi les campagnes, on réduit les distances entre producteur et consommateur, ce qui améliore encore l’efficacité.
Pour que ce système ne soit pas plus coûteux que le système actuel (et je ne compte pas les coûts cachés), il faudrait qu’un paysan travaillant en circuit court (AMAP ou marché de producteurs) puisse nourrir 7 familles. Ca doit être faisable, non ?